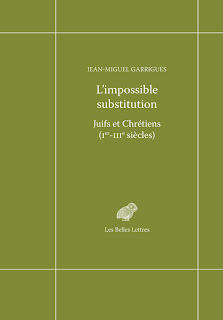GARRIGUES J.-M., L’Impossible substitution. Juifs et chrétiens
(Ier-IIIe siècles), Les Belles Lettres, 2023.
À l’heure où, une fois de plus dans sa longue histoire, la Terre
Sainte est en feu, la question religieuse faisant toujours partie des conflits
dans cette région du monde, il est d’autant plus important de travailler à la
compréhension mutuelle et de chercher des chemins nouveaux d’une fructueuse
fraternité, au moins entre juifs et chrétiens. Ce livre contribue à cet effort,
aussi dure que puisse être la leçon pour les chrétiens, en l’occurrence. On peut
subdiviser l’étude en deux parties principales :
La première partie exégétique est parfois longue, confuse et
discutable sur la méthode employée. L’auteur recherche les thèmes théologiques,
eschatologiques et ecclésiologiques de l’Église apostolique et ce qui concerne
la partie d’Israël qui résiste ou s’oppose à l’Évangile, surtout en raison de l’ouverture
de la Rédemption aux Gentils. L’exposition, très paulinienne à bon droit, s’appuie
indifféremment sur les évangiles et les autres écrits en les prenant comme un corpus
a priori cohérent et de manière presque anachronique. On le comprend :
à distinguer la vision de chaque évangéliste, ou auteur du Nouveau Testament, il
y a un risque de les opposer inopportunément, et il est difficile – sauf à
entrer dans des controverses irrésolues – de les ordonner chronologiquement.
Mais cela fragilise d’autant cette première partie de l’étude : il eut
peut-être mieux valu tâcher de distinguer davantage ce qui était propre à Paul en
regard des témoignages évangéliques et des Actes. Un nœud particulièrement
difficile à traiter est celui de la destruction du Temple, de sa datation et de
sa signification tant pour les juifs que pour les chrétiens.
La seconde partie patristique est inversement beaucoup plus
facile à lire, claire et redoutablement efficace quant aux propos tenus :
elle est décapante. On y voit se développer en l’espace de deux siècles un
rejet de l’Église de la circoncision et à travers elle du judaïsme, toléré au mieux
comme un témoin de l’Ancien Testament (Augustin).
Deux types d’auteurs peuvent être distingués : ceux qui
à l’instar d’Irénée, Augustin et Thomas d’Aquin vont malgré tout tenir une
ligne ouvrant à un discours relativement positif sur la vocation propre du
judaïsme en dehors de l’Église – en attendant le retour du Christ ; et
ceux qui comme Ignace d’Antioche (qui invente le terme « christianisme »,
p. 148), Justin (qui voit en la défaite de 135 une condamnation de la
circoncision, p. 155), Tertullien (qui le premier emploie le terme « déicide »,
p. 188) et Origène vont au contraire condamner le judaïsme, le vouer au
néant, et lui « substituer » (Cyprien, p. 201) l’Église comme
nouvel et seul Israël possible.
Le chapitre sur Origène est particulièrement à charge. Il
faudrait peut-être tenir compte du fait que l’exégèse typologique d’Origène lui
fait dessiner des figures en partie indépendamment du sujet réel qu’elles
représentent. Par exemple, pour lui, un spirituel sera un « homme »,
tandis qu’un charnel sera une « femme », en raison de sa faiblesse. De
même, il est possible qu’un homme non illuminé spirituellement par le Christ
demeure un « juif », quand bien même il serait baptisé. Une lecture
littérale de l’exégèse d’Origène est risquée – et je crains que J.-M. Guarrigues
ne tombe trop facilement dans ce piège – mais Origène lui-même la rend risquée,
il faut le reconnaître.
À travers cet ensemble se dégage la thèse de l’auteur (inspirée
semble-t-il de Mark Kinzer). Il a existé (il existe) une Église de la
circoncision en laquelle la Loi demeure pratiquée (p. 118), distincte de l’Église
de la gentilité, dispensée de l’obéissance aux préceptes de la Loi. Car la Loi
ne s’applique pas au-delà de la mort (Daniel Gottlieb, p. 37-38) et l’Église
est déjà une anticipation du Royaume, quoique sujette à la tension
eschatologique (p. 59), c’est-à-dire de manière sacramentelle (p. 77). La
négation de cette tension eschatologique pousse soit à considérer comme Gershom
Scholem que la rédemption proposées par Jésus a échoué, par ce que « la transformation
intime » (pharisiens) qu’il propose ne « modifie pas l’histoire »
(zélotes), soit que l’Église actuelle est déjà pleinement le Royaume, ce qui
conduit à l’exclusion du judaïsme de l’histoire (p. 81).
L’Église de la circoncision – celle de Jérusalem et en
partie celle de Rome composée au départ majoritairement de juifs – était
garante de l’enracinement de l’Église dans le judaïsme, notamment par le fait
que la hiérarchie de cette Église était initialement issue de la famille même
de Jésus. Par nature, elle dispensait pour toute l’Église un antidote aux dérives
gnostiques (Marcionisme). Sa disparition institutionnelle, après la chute de
Jérusalem en 135, ouvre la voie à la « théorie de la substitution ».
Cette lecture nous appelle à quelques réflexions.
L’auteur constate, à travers ses dossiers patristiques
successifs, la dérive antijudaïque de la « Grande Église ». Ce
faisant, il n’en cherche pas la ou les causes, sinon par allusion et sans
vraisemblablement en prendre conscience. Un point commun à tous les auteurs
effaçant la vocation de l’Église de la circoncision et au-delà d’elle celle de
l’Israël demeurant hors de l’Église jusqu’à la venue du Christ, est qu’ils
partagent un même fondement philosophique à la théologie (surtout chez les
Alexandrins) et non pas un fondement historique. Pourtant on peut lire à propos
de Tertullien : « Quelle que soit la part de vérité que contient ce
que dit Tertullien sur la Loi éternelle […] c’est en quelque sorte une religion
dans les limites de la raison, c’est-à-dire réduite à la morale naturelle, que
Tertullien propose ici. Le croyant qui a une foi façonnée par l’histoire du
salut biblique sait que l’Alliance et la Promesse précèdent la Loi dans un
dynamisme théologal qui assume mais dépasse la morale, car il conduit jusqu’à
la vie avec Dieu. » (p. 184-185).
S’il est exact que jusqu’en 135 au moins Église de la circoncision
et Église des Gentils ont coexisté, avec dans un cas l’observance intégrale de
la Loi et dans l’autre sa non-observance, alors qu’en était-il de l’eucharistie
dominicale a priori nécessairement commune dans un même lieu ? On
doit déduire de cet état de fait que très tôt, tout en demeurant de structure parfaitement
juive, elle a dû être distinguée des repas où des règles différentes devaient s’appliquer
quand les communautés étaient mixtes. Il me semble que cette observation n’a
jamais été prise en compte dans l’histoire de la liturgie ?
La question du Temple et celle du culte mosaïque peuvent-elles
être séparées de l’observance de la Loi ? Il ne semble pas que jusqu’en
135 les juifs chrétiens se soient d’eux-mêmes séparés de l’un et de l’autre :
ils étaient pour eux compatibles avec leur foi. Il nous semble qu’il y a là un
chantier encore à débroussailler, en conservant à l’esprit le mystère du récit
de la Transfiguration, où « l’assemblée messianique qu’il [Jésus] vient de
fonder sur Pierre est d’abord celle du peuple d’Israël » (p. 72) et l’opinion
de saint Thomas que l’Ancien testament et le Nouveau sont « simultanément » des
figures des réalités célestes (p. 172, Thomas
d’Aquin, Quodlibet VII, a. 2, c.). Même si l’on peut penser d’un
point de vue chrétien que la liturgie chrétienne est davantage en rapport avec
la réalité du Royaume que celle du Temple, figure plus éloignée mais pas moins intrinsèquement
conforme (ce en quoi elle peut être aussi préfiguration de la liturgie
chrétienne).
Le dossier patristique à charge est de nature à disqualifier
en grande partie la ou les théologies des Pères, et bien au-delà, en vertu du
caractère organique des éléments de la foi. Il s’agit donc d’être prudent et
patient.
La remise en cause, pour beaucoup, de leur exposition de l’histoire
du salut appelle à dégager à nouveaux frais un « chemin historique de l’orthodoxie »
(pour reprendre un titre du P. Alexandre Schmemann), où les Écrits de l’époque
apostoliques (Didachè, Odes de Salomon, Homélies pseudo-clémentines, la Lettre
à l’Église de Corinthe attribuée à Clément, le Pasteur d’Hermas –
voir p. 142-144), les enseignements d’Irénée et saint Thomas pourraient constituer
des repères plus solides.
La clarification doit aussi venir d’une exégèse renouvelée
faisant davantage droit aux apports araméens/syriaques susceptibles d’avoir
conservé une tradition plus conforme à celle de l’Église des circoncis, en
raison de l’appartenance à une langue et une mémoire commune, que les seuls apports
grecs, naturellement en accointance avec l’Église des Gentils, ne peuvent
garantir.
On s’aperçoit alors que le salut passe d’abord par un
travail de réappropriation de nature historique, où il s’agit de se replonger
dans les racines de l’Israël de Jésus, Christ, avec l’aide de la raison
philosophique, mais pas a priori.